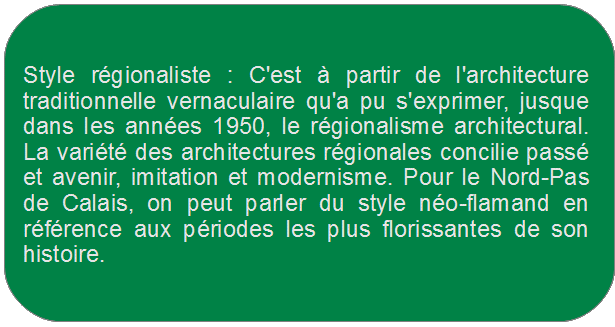La taille des Grands Bureaux reflète la puissance industrielle de la Compagnie des Mines.
81 mètres de longueur, 3 pignons à redents de 38 mètres de hauteur
Le recours à l'urbanisme et à la planification d'ensemble a été nécessaire pour concevoir en parallèle une reconstruction et une modernisation de la ville. Ceci s'est traduit par des espaces urbains emprunts de fonctionnalisme (zonage) et d'hygiénisme (rues et espaces publics aérés). Pour la Société des Mines de Lens, il était nécessaire de renouer avec les racines patrimoniales de la région. Les architectes, Louis-Marie Cordonnier et son fils ont mis en avant les caractéristiques de l'architecture régionaliste.
Les travaux débutent le 12 juillet 1928 par les fondations et l'ossature en béton. Cet imposant ouvrage est réalisé par l'entreprise lensoise de génie civil et de travaux publics, sous la direction de M. Rouger. Le bâtiment reçoit un revêtement de briques fabriquées par la briqueterie de Douvrin (filiale de la Société des Mines de Lens). 200 ouvriers œuvrent dans ce chantier colossal.
La taille des Grands Bureaux reflète la puissance industrielle de la Compagnie des Mines.
81 mètres de longueur, 3 pignons à redents de 38 mètres de hauteur
- La monumentalisation
- L'ossature comme élément de décor (épis de faîtage en forme de bulbes, bow-windows, pignons à redents)
- La recherche subtile des couleurs et des textures (utilisation de la brique de Douvrin et de la pierre blanche)
- La disposition des éléments de maçonnerie (lignes verticales et horizontales, ouvertures rectangulaires et élancées)
- La modénature (frises, corniches, corbelets, encadrements des baies, appuis de fenêtres, linteaux, lamiers, soubassement, bandeau horizontal)
- Les toits pentus ornés de lucarne